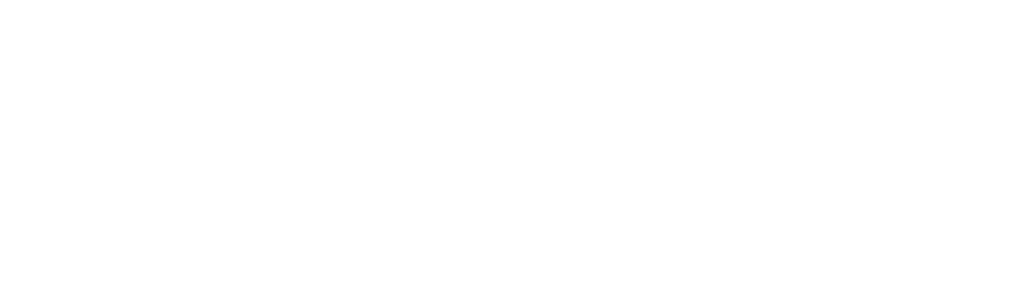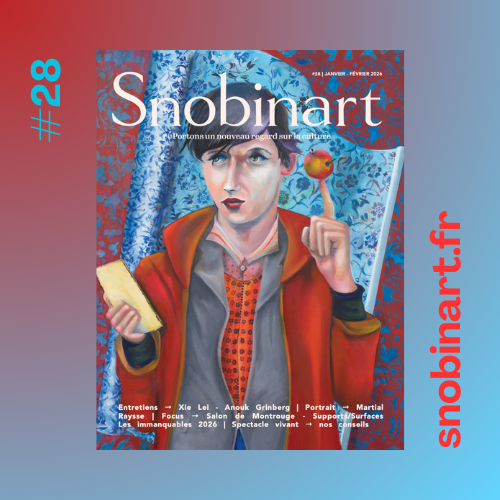D’origine ukrainienne et installée en France depuis plusieurs années, Olga Dukhovna a su se faire une place de choix dans le paysage chorégraphique contemporain. Danseuse pour Boris Charmatz ou Maud Le Pladec, elle développe également sa propre écriture, qui a pris un nouveau tournant au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Olga Dukhovna renonce alors à son projet de monter Le Lac des Cygnes pour 32 interprètes commandé par le nouveau musée de Moscou, et lui préfère une version resserrée, réinventée, libre, qu’elle portera seule.
Avec Swan Lake solo, la chorégraphe affirme également un certain goût pour le « recyclage », comme elle l’appelle elle-même, un travail qui est également au cœur de sa nouvelle création intitulée Hopak (prononcer « Gopak »). C’est au cours d’une résidence dans le studio mobile de La Maison Danse – CDCN d’Uzès, qu’Olga s’est confiée sur son travail. Quelques minutes avant cet entretien, la pièce Hopak encore en répétitions vient d’être mise bout-à-bout pour la première fois. Elle sera notamment présentée au public à l’occasion du festival uzétien le 9 juin 2024.
On se rencontre en pleine création de ta nouvelle pièce, qu’est-ce qu’elle raconte ?
Olga Dukhovna : Ça s’appelle Hopak, c’est le nom d’une danse ukrainienne. C’est comme si je choisissais la danse la plus célèbre et que je donnais son nom au spectacle. Mais il y a plein de danses différentes qu’on utilise comme base pour cette pièce. L’idée principale, c’est le recyclage de danses existantes, notamment la partie masculine des danses ukrainiennes. J’ai déjà fait une partie féminine à la fin de mon master au CNDC d’Angers (Centre National de Danse Contemporaine, ndlr). Donc j’ai déjà fait ça, et ici, c’est ce que les hommes dansent. Je me suis rendu compte que ce qui m’intéresse en tant que chorégraphe, ce n’est pas tant de trouver un nouveau mouvement, de trouver mon geste, mon style, comme Trisha Brown. Ce qui m’intéresse beaucoup plus, c’est de partir de quelque chose d’existant, ce que j’appelle « recyclage ». Je le prends vraiment comme du recyclage. C’est comme si je venais d’une autre planète et que je regardais une bouteille en plastique sans rien connaître des bouteilles ou du plastique. Je regarde cette matière et je me demande vraiment ce que c’est. C’est quoi cette chose ? Qu’est-ce que je peux faire avec ? Qu’est-ce que ça va donner si je fais ça, si je fais ci ? C’est un processus très formel. Aujourd’hui, les danses ukrainiennes sont des danses perdues, pas comme les danses bretonnes par exemple. Ce sont des danses complètement perdues, et tout ce que j’ai pu trouver, ce sont déjà des adaptations scéniques de ces danses. Donc elles ne sont pas très authentiques.

Elles ne sont plus pratiquées du tout ?
Olga Dukhovna : Plus du tout, à cause de l’Union Soviétique. C’est comme n’importe quel empire, la première chose qu’ils ont faite c’est d’enlever la langue et t’interdire les danses, la religion… Pour qu’il n’y ait plus de nations différentes, que tout le monde soit pareil. Tout a été interdit, on a tout perdu. Les danses avaient vraiment fleuri dans les années 20, 30. Il y a eu plein de choses très intéressantes, on n’était pas du tout en retard. Puis il y a eu tous ces temps soviétiques où c’était complètement autre chose. C’était les parades, tout était contrôlé et centralisé, ils décidaient de ce qu’était la culture. Après la chute de l’URSS dans les années 90, on a eu d’un coup cet accès à la culture européenne. Il y a une sorte d’adoration pour cette culture européenne. On adore, on aimerait faire comme ça aussi, mais on ne sait pas comment. Du coup, il y a beaucoup de « copy paste ». C’est comme si on copiait la forme, mais sans savoir ce qu’il y a à l’intérieur. Ça devient un peu faux, c’est un peu bizarre. Pour moi, c’est très intéressant. C’est pour ça que j’ai pris les danses folkloriques ukrainiennes. Ce n’est pas nécessairement parce que je voulais vraiment aller à la base, mais parce que c’est tout ce qui reste de la danse purement ukrainienne. Après, on n’a plus rien.
C’est la dernière chose qui marque vraiment une identité propre…
Olga Dukhovna : Oui, parce qu’après c’était purement soviétique. Après la perestroïka, ce n’était pas si simple de dire : « Mais qu’est-ce que c’est, en vrai, la culture ukrainienne ? ». Il y a eu cette grande polémique quand la guerre a commencé. Les Russes ont affirmé qu’il n’y avait pas de culture ukrainienne, que ça n’existait pas, que l’Ukraine n’existait pas. Pour beaucoup d’artistes ukrainiens, ça a créé cette envie ou cette urgence de dire : « Comment pouvez-vous dire que la culture ukrainienne n’existe pas ? ». Si moi, en tant qu’Ukrainienne, je fais quoi que ce soit, ça devient une culture ukrainienne, point barre. Bien sûr, je voulais aller chercher des danses ukrainiennes pour faire mon recyclage… Mais c’est quoi la différence entre les danses folkloriques russes et ukrainiennes ? Ce n’est pas si évident. J’ai dû faire une vraie recherche dans cette culture qui est complètement là, mais je ne la connais pas tant, parce qu’elle a été effacée par la culture soviétique. Et comme je suis née pile l’année de la perestroïka, même le temps soviétique je ne le connais pas. Je suis vraiment d’une sorte de génération perdue. On était entre les deux, on n’était pas encore l’Ukraine. Bien sûr que la base, c’est les danses ukrainiennes, mais tout ce que je te dis, c’est mon histoire personnelle. C’est pourquoi je voulais le faire. Mais c’était absolument crucial que ce ne soit pas une pièce « Olga personal trip ». Le but, c’est de ne pas faire pleurer les Ukrainiens parce que ça les touche personnellement. J’ai regardé une pièce basée sur les danses bretonnes, j’ai vu que c’était bien fait, mais ça ne m’a pas touchée tant que ça. Pourtant les gens ont pleuré, parce que les gens connectent tellement avec ces choses-là, ça leur rappelle leur grand-mère ou des choses comme ça. Et là, je me suis dit : « Je ne peux pas faire ça avec la danse ukrainienne, c’est impossible ». Ça voudrait dire ne jouer que pour l’Ukraine, ça ne m’intéresse pas. L’idée, c’était quand même de prendre ça comme base et au contraire, de vider ça complètement et de retravailler cette forme avec des choses universelles.
À voir ces répétitions, tu donnes l’impression de travailler beaucoup sur la dualité. Il y a toujours une chose et son contraire : le bruit et le silence, la rapidité et la lenteur, l’accordéon et la musique électro, deux interprètes au plateau… C’est voulu, ces oppositions permanentes ?
Olga Dukhovna : J’adore le travail des oppositions. Mais pas que pour cette pièce, en général. Pour moi, ça représente la vie. On a parlé de ça d’ailleurs avec Simon, qui est mon dramaturge. Il m’a demandé pourquoi il y a ce préambule avec les visages qui ont de grands sourires jusqu’à une complète dépression. Là, on travaille deux états : la fierté extrême de son pays, le patriotisme, et si on va à l’inverse de ce geste, on trouve une déception énorme. Tu vois pourquoi j’adore les oppositions ? Parce qu’on vit entre les oppositions, tout le temps. On est tout le temps entre joie énorme et profond désespoir. Des fois, tu es tellement malheureux et il suffit d’une personne gentille, qui prend soin de toi, et tu peux repartir dans l’autre sens. Ça représente la vie. S’il n’y a pas d’oppositions, on est mort. Quand on a travaillé la dernière partie de Hopak, qui normalement devrait être la plus calme et stable, je me suis dit : « la symétrie, c’est la stabilité ». Dans le bon sens, c’est juste quelque chose de stable. Et en même temps, on peut se dire que c’est presque une représentation de la mort parce qu’il n’y a plus de mouvement. Là, c’est mort parce que c’est stable.

Le travail que tu as pu faire sur Swan Lake Solo, par contre, c’est autre chose. Là, tu pars de quelque chose qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus universel que les danses ukrainiennes. Quelle est ta démarche, à ce moment-là ?
Olga Dukhovna : C’était plus simple avec Swan Lake, parce que je savais que tout le monde connaissait. En plus, je n’ai pris que les grands clichés. Mais je n’ai pas du tout suivi l’histoire de Swan Lake, pas du tout. Ce qui était intéressant, c’était de travailler avec cette matière, vidée de tout son contexte, d’autant que je danse toute seule. Là, il n’y a plus de différence entre corps de ballet, solo, prince, princesse, blanc, noir, parce que c’est moi qui fais tout, de toute manière. Du coup, j’ai piqué le matériel que je voulais dans n’importe quel ordre. Ce qui m’intéressait, c’était vraiment de partir des morceaux les plus connus et à partir de là voir jusqu’où on peut aller. Et on peut aller très loin, je peux te le dire ! D’ailleurs, cette histoire de dualité, je l’ai beaucoup développée dans ce monde-là. Parce que c’est la seule chose que j’ai gardée de l’histoire, c’est vraiment ce truc de choix entre noir et blanc. Ça m’a toujours étonnée que tout le monde prenne ce ballet comme une histoire d’amour. Pour moi, c’est purement histoire de choix, et surtout d’une promesse que tu ne peux pas tenir. Ça n’a rien à faire avec l’amour.
Tu attends quoi de la suite de ton travail ? Quelles pistes as-tu envie de creuser ?
Olga Dukhovna : Je suis chorégraphe associée au théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, et on a une sorte de programme jusqu’en 2026. Je sais qu’en 2025, je vais préparer… J’ai toujours rêvé de faire ça… Pas une pièce, mais un événement pour la ville qui serait un peu autour de Hopak, avec un peu de culture ukrainienne, mais encore une fois à ma manière. Il ne faut pas avoir peur, il n’y aura pas trop de folklore. Les danses folkloriques, c’est ce truc de victimisation. On sait qu’il y a la guerre, mais on ne peut pas regarder ça comme ça. Pour moi, cet événement, c’est une célébration après la guerre, dans ma tête. Il y a un projet comme ça déjà en route. Et deuxième chose que j’ai trop envie de faire, c’est une sorte de conférence sur « C’est quoi la différence entre recyclage et plagiat ? ». Je vais parler de plein d’exemples que j’adore personnellement, il y a des histoires vraiment incroyables. Et au lieu de montrer les vidéos comme exemples, l’idée c’est que je vais danser tous les exemples moi-même. Je ne sais pas ce que ça va donner. De toute manière, j’adore le recyclage. Il y a toujours les questions « Mais alors, Olga, chorégraphe qui n’invente pas ses mouvements, c’est quoi ça ? »… Mais je kiffe, c’est un thème qui m’intéresse, j’aimerais creuser encore plus…
Ça n’est pas une manière de t’expliquer…
Olga Dukhovna : Non, je ne veux pas me défendre. J’adore tellement le thème que je veux aller encore plus loin. Je me suis déjà beaucoup intéressée au recyclage de danse de plusieurs manières et pour plusieurs raisons. J’ai dansé pour Boris Charmatz dans le projet 20 danseurs pour le XXe siècle. J’ai fait les danses de Charlie Chaplin, de Buster Keaton et j’ai absolument adoré parce que c’est là où je me suis dit : « En fait, le geste ne peut pas être démodé ». Ce qui peut être démodé, c’est le contexte, les costumes, la musique, l’esthétique. Mais si on prend juste le geste, qu’on nettoie tout ça et qu’on regarde le geste pur, net, c’est très intéressant, ça ne peut pas être démodé. Il s’agit juste de regarder ce qui reste, et à partir de là, de se sentir absolument libre. Voilà cette forme, qu’est-ce qu’on peut faire avec ? Qu’est-ce qui se passe si on accélère, si on décélère ? Qu’est-ce qui se passe si on fait ça sur une musique contemporaine, sur une musique classique ? Si on coupe un morceau ?